
Les objets, qu’ils soient monuments dans la ville, meubles dans la maison, vêtements à l’échelle du corps, outils de la vie quotidienne, accompagnent l’humain depuis toujours. Depuis toujours aussi, ils se modifient en fonction des progrès, des civilisations, des cultures.
Aujourd’hui, après la révolution de l’ère industrielle, apparaissent les mutations profondes liées à l’émergence d’objets intelligents (satellites, ordinateurs, fax, cartes à puce...), aux questions vitales posées par une terre qui s’épuise en énergie, à l’apparition de marchés liés à la qualité de l’objet, à sa signification et non plus à son seul usage.
Ces bouleversements amènent-ils ou non les chefs d’entreprise à repenser leur activité ?
Cette activité devient-elle une mission, à l’instar des concepteurs, des architectes et des designers, dont le rôle n’est plus celui d’une création isolée, liée à l’existence d’un produit, mais la manifestion d’une pensée, d’une réflexion sur le monde d’aujourd’hui ?
Cet ouvrage tend moins à démontrer une théorie, défendre un parti ou dégager des solutions adaptées qu’à souligner un état de fait, révéler des contradictions, interroger des paradoxes. Il met en lumière cette relation productive, nécessaire et créative, qui est - ou devrait être, plus largement que dans les neuf cas de figures exemplaires présentés ici - celle de l’industrie et de la création.
Le même et le différent
La logique la plus préhensible de l’industrie se résume au principe de la série. Petite, moyenne ou grande, c’est la répétition du “même” qui dégage des marges bénéficiaires et permet à l’outil industriel de perdurer dans la stricte loi de rentabilité qui est la sienne, garante de son existence et de sa survie.
Pendant quelques décennies, la logique d’entreprise axée sur les coûts se présentait sous deux aspects :
D’un côté, les coûts de production, de l’autre, et pour permettre au produit d’exister, la publicité, autant dire la communication du produit au plus grand nombre.
Petit à petit pourtant, les entreprises les plus sensibles aux changements de société ont commencé à percevoir la nécessité de l’identité du produit. Et peu à peu, le produit est lui même devenu sa communication, il s’est chargé de sens, de signes, d’affect, à l’opposé de la pure théorie fonctionnaliste, sans pour autant bannir la fonction. Mais, parallèlement à la nécessité d’offrir des objets “narratifs”, se sont affirmées les différences.
Aujourd’hui, les industries d’avant-garde ne pensent plus en fonction d’un marché mais de plusieurs marchés, regroupant des identités culturelles variables.
Le produit novateur et le produit balisé
Pour concevoir ce produit “différent”, les industriels font appel aux designers, ces créateurs qui acceptent une part de risque et n’envisagent pas l’objet dans la seule dialectique du fonctionnement et de l’esthétique. Ils y ajoutent un jeu éthique qui va de l’art à l’usage - ou de l’usage considéré comme un art.
Alors se pose l’éternelle question du temps.
Jusqu'à quel point un produit novateur est-il acceptable par un marché alors même qu'il vise à le renouveler ?
Et bien sûr la forme ou l’apparence ne sont pas seules en cause, mais aussi la fonction et le concept même de cet objet, de son usage et de son image.
Jeu de miroir entre l’individu et l’objet, qui répond à une demande ou la révèle, ou même l’invente.
C’est à cette interface entre le connu et le nouveau, le passé et l’avenir, le programme et le projet, que se situe le travail des createurs
L’irrationnel et le rentable
La création contient sa part nécessaire d’irrationnel. Quelle que soit leur démarche, les designers, les architectes et les créateurs évoquent le moment d’intuition qu’aucune pensée, aucune théorie ne peut circonscrire. Le processus le plus rationnel, le plus structuré et le plus conscient des contraintes passe par cette phase qui ne peut s’objectiver, mais qui définit précisément le créateur, sa capacité à cristalliser toutes les données en une alchimie personnelle, à nulle autre semblable.
Ce discours du mystère, du langage et de l’émotion est aux antipodes de l’uniformisation. Et pourtant, aussi diversifiée, intelligente qu’elle soit, la démarche de l’industrie passe par l’uniformisation, qui lui est inhérente.
Le dialogue entre industriels et créateurs est ainsi le résultat
d’un paradoxe, que le produit à la fois exprime et dépasse
lorsqu’il atteint son but. Mais comment ces protagonistes contraires
et indissociables s’affrontent-ils, se confrontent-ils et s’entendent-ils
pour créer, ensemble, un produit ?
Sur le mode du dialogue, qui est peut-être la forme la plus proche
de ce que ce livre tend à mettre en lumière : la relation,
les neuf industriels et les neuf créateurs relatent leur vision
et définissent leur place, offrant chacun un angle de vue différent,
puis l'histoire d'un produit mené à bien en commun.
A l’interface de ces deux discours demeurent les questions, les domaines
à explorer, les pleins et les vides, à la fois la magie
et le réel, d’un champ de réflexion et de réalité
qui concerne l’ensemble de l’économie et de l’environnement.
L'enjeu est concret.
L’enjeu
Pour les industriels, la rentabilité passe aujourd’hui par
des défis qui ne sont plus ceux de la seule consommation. Celle-ci
requiert de nouvelles attitudes.
Ainsi, la fin du XX ème siècle verra-t-elle peut-être
se réaliser l’utopie des modernes : la rencontre du beau et
de l’utile, le passage de la quantité d’objets et de
la surconsommation à la qualité intrinsèque d’objets
polyvalents.
De même se précise le rôle culturel de l’industrie.
Elle façonne l’environnement immédiat et l’environnement
futur. Chargée de sens, la production devient discours sur le réel,
et culture du présent en marche. Pourtant, issue de l’artisanat,
puis des manufactures et enfin de la production en grande série,
elle se doit d’assurer la continuité, l’entente entre
tradition et modernité.
Pour les créateurs, l’enjeu n’est pas moindre. Certains
d’entre eux réfléchissent à ce qu’ils appellent
la “disparition”. Encombré, parasité par un surnombre
d’objets, le monde est voué à étudier le minimum.
Minimum de matière, maximum de service. Le chapitre consacré
à la carte à puce électronique relève de cette
logique. L’objet n’est plus que surface tandis que la fonction,
intériorisée et invisible, prend le relais de l’intelligence.
Pourtant, un langage des objets demeure, plus que jamais, nécessaire,
écho, reflet ou révélateur des identités.
Entre objet sensible, pensé avec sa part d’irrationnel et
objet de pure immatérialité, de stricte intelligence, où
se situent aujourd’hui le projet et sa signification ?
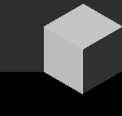 |